 Newsletter #606 – 23 juillet 2025 Newsletter #606 – 23 juillet 2025 Tribune « Olympisme. Une histoire du monde… en héritage » par le Groupe de recherche Achac À travers ce programme, le Groupe de recherche Achac invite à découvrir son exposition « OLYMPISME. Une histoire du monde… en héritage» conçue avec le soutien de la DILCRAH, de l’ANCT, et de la Dgesco (ministère de l’Éducation nationale), mais aussi les grands événements au cœur de ce projet, notamment le colloque « Héritages olympiques des Jeux 2024 aux défis des Alpes Françaises 2030 » organisé dans le cadre du grand congrès « Les Enjeux des Jeux » à l’Université de Toulouse en décembre 2025. À travers un parcours riche et documenté, l’exposition, qui retrace l’histoire des Jeux Olympiques, s’inscrit dans une histoire mondiale. Car les Jeux ne sont pas qu’une simple affaire de sport, ils ont toujours été le reflet de la société et de ses aspirations, des enjeux sociétaux et politiques qui la déchirent, gravant ainsi chaque événement dans un contexte unique. Féminisme, décolonisation, guerre… Chaque nouvelle édition narre notre histoire collective. Cette exposition ambitionne de bouleverser les connaissances et notre compréhension des Jeux, et rappelle que derrière ce divertissement, se déroulent des combats. Lire la tribune Réserver l’exposition Le programme provisoire du colloque Lien les Enjeux des Jeux Webinaire « Madagascar, la France, l’Afrique : Mémoire coloniale, restitutions, îles Éparses, diplomatie… » Jeudi 24 juillet 2025 de 18h00 à 19h00 Diapason Dans le cadre de ce webinaire, Harilala Ranjatohery, historien et académicien, spécialiste de l’histoire politique et culturelle de Madagascar, membre de l’Académie malgache et engagé dans le travail de restitution de la mémoire nationale et des résistances, dialoguera avec Pascal Blanchard, historien (CRHIM, Lausanne), spécialiste de la colonisation et des mémoires postcoloniales, auteur de François Mitterrand, le dernier empereur (Philippe Rey, 2025) et du documentaire Décolonisations, du sang et des larmes (France 2, 2020). À travers cet échange, les deux intervenants aborderont la mémoire coloniale à Madagascar, en soulevant les enjeux contemporains liés aux héritages coloniaux, aux mémoires longtemps occultées, ainsi qu’à la diplomatie à inventer face aux silences persistants de l’histoire entre la France et madagascar. Ce débat, accessible en direct sur internet, s’inscrit pleinement dans les réflexions actuelles sur la manière de penser et de transmettre ce passé. En savoir plus Découvrir l’ouvrage Découvrir le documentaire Article « ll y a 100 ans, Grenoble installait un zoo humain au parc Mistral… » Publié le 17 juillet 2025 Le Dauphiné Libéré À l’occasion du centenaire de l’exposition internationale de la houille blanche, Ève Moulinier, journaliste au Dauphiné Libéré, revient sur un épisode oublié de l’histoire grenobloise : l’installation d’un « zoo humain » en 1925. Du 21 mai au 25 octobre, des hommes et des femmes y furent exhibés dans des décors exotiques, selon une mise en scène coloniale déshumanisante. Cette histoire sera rappelée en septembre 2025 à la Maison internationale de Grenoble, à travers l’exposition « Zoos humains. L’invention du sauvage », conçue par le Groupe de recherche Achac en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram. Un panneau inédit, consacré à l’édition grenobloise de 1925, viendra compléter l’exposition. L’historien Pascal Blanchard et l’historienne Sandrine Lemaire apporteront leurs éclairages lors d’une conférence prévue le 22 septembre 2025 sur ce passé, les zoos humains et Grenoble 1925. En France, plusieurs associations réclament aujourd’hui la restitution des corps de personnes exhibées au XIXe siècle, mortes dans des conditions indignes dans ces exhibitions coloniales. L’association Moliko Alet+po porte ainsi un projet de caveau funéraire destiné à rapatrier huit dépouilles arawak et kali’na, présentées lors des expositions ethnographiques en Europe de 1882 et 1892. L’article Le Dauphiné Libéré Le projet de Moliko Alet+po « Zoos humains. L’invention du sauvage » France Podcast « Insoumises : un siècle de féminisme africain sous la colonisation » Diffusé le 18 juillet 2025 RFI Dans ce dernier épisode du podcast Afrique, mémoires d’un continent, l’écrivain et journaliste Elgas explore l’histoire de femmes africaines engagées dans des luttes pour leurs droits, menées dans des contextes profondément marqués par le patriarcat et la domination coloniale. Malgré les obstacles structurels, ces trajectoires singulières, longtemps reléguées aux marges du récit historique, ont façonné les dynamiques sociales et politiques de leurs sociétés. L’épisode réhabilite la place de ces figures féminines dans l’histoire africaine, en soulignant la pluralité de leurs engagements et la portée de leurs combats. Il s’enrichit des analyses croisées de Madina Thiam, historienne et professeure adjointe à l’Université de New York, et de Pascale Barthélémy, historienne, directrice d’études à l’EHESS et membre de l’Institut des mondes africains, toutes deux spécialistes des histoires de genre, de savoirs et de résistances sur le continent africain. En savoir plus France Documentaire « Les ombres du Groenland : enquête sur les stérilisations forcées des femmes inuites » Jusqu’au 30 juillet 2025 France 24 Réalisé par la journaliste franco-danoise Sarah Andersen, avec une photographie signée Sébastien Daguerressar, ce documentaire explore la politique de contrôle des naissances imposée par le gouvernement danois aux femmes inuites dans les années 1960. Durant cette période, des milliers de jeunes filles ont été contraintes à la pose de stérilets, sans information préalable ni consentement éclairé. En donnant la parole aux victimes, ce film met en lumière une page sombre et encore largement méconnue de l’histoire coloniale du Danemark, longtemps reléguée au silence. En savoir plus France Timbre Gisèle Halimi (1927-2020) À paraître le 28 juillet 2025 La Poste La Poste émet prochainement une série de timbres consacrée à Gisèle Halimi, figure majeure du féminisme et du droit en France. Née en 1927 en Tunisie, alors protectorat français, Gisèle Halimi s’est distinguée par son engagement en faveur des droits des femmes et des libertés individuelles, notamment à travers sa carrière d’avocate, d’écrivaine et de militante politique. Décédée en 2020, cette émission philatélique constitue un hommage officiel à son œuvre et à son influence durable sur le paysage juridique et social français. Dans un même esprit, l’exposition «Portraits de France », conçue par le Groupe de recherche Achac en partenariat avec le Musée de l’Homme, avec le soutien de l’ANCT et de la DILCRAH, présente le parcours de Gisèle Halimi dans le contexte plus large des contributions de personnalités issues de l’immigration et des territoires d’Outre-mer. L’exposition met en lumière leur rôle dans l’évolution politique, sociale et culturelle de la France contemporaine, offrant une réflexion sur les dynamiques de l’intégration et de la diversité au sein de la société française. En savoir plus « Portraits de France » France Article « À Marseille, un temple du prêt-à-porter fait son inventaire colonial » Publié le 17 juillet 2025 Le Monde Le journaliste Gilles Rof consacre un article au travail de recherche mené par un groupe d’étudiants en sciences politiques, encadrés par leur enseignant, autour d’un bâtiment discret mais remarquable, situé à deux pas du Vieux-Port de Marseille. Derrière sa façade raffinée, aujourd’hui occupée par une boutique de vêtements, se dissimule un pan oublié de l’histoire coloniale. En s’attachant aux éléments architecturaux et décoratifs du lieu, les étudiants ont entrepris une enquête rigoureuse pour en restituer la mémoire. Leur démarche, à la croisée de l’analyse urbaine et de la pédagogie historique, vise à rendre visible ce que la banalisation tend à effacer : la persistance, dans l’espace public, des marques matérielles du passé colonial. À travers ce travail, ils proposent une autre lecture de la ville, attentive à ses strates invisibles et soucieuse de transmission. Et pour aller plus loin, le portail « Mars Imperium », porté par Céline Regnard et Xavier Daumalin, professeurs d’histoire contemporaine (Université Aix-Marseille), recense les connaissances actuelles sur l’histoire coloniale et postcoloniale de la cité phocéenne. En savoir plus Mars Imperium France Article « Saartjie Baartman, La Vénus hottentote » Publié le 18 juillet 2025 Afrique XXI Cet article de Nicolas Michel, romancier et journaliste, retrace le parcours de Saartjie Baartman, connue sous le surnom de « Vénus hottentote ». À partir de 1810, elle fut exposée publiquement à Londres puis à Paris, dans le cadre d’exhibitions ethnographiques qui préfigurent les « zoos humains » des décennies suivantes. Saartjie Baartman fut présentée comme une curiosité scientifique et médiatique, son corps faisant l’objet d’observations, de moulages et d’études à des fins raciales et coloniales. Son histoire illustre les mécanismes d’objectivation et de déshumanisation mis en œuvre dans le contexte du racisme scientifique et des pratiques coloniales du XIXe siècle. L’exposition « Zoos humains. L’invention du sauvage », conçue par le Groupe de recherche Achac en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram, propose une analyse historique de ces phénomènes à travers le regard porté sur les personnes exhibées en Europe et ailleurs (elle sera à Grenoble au mois de septembre 2025). En savoir plus « Zoos humains. L’invention du sauvage » France Vidéo « Comment 3 600 objets africains sont arrivés en France ? La Mission Dakar-Djibouti » Publié le 29 juin 2025 Histoire Crépues La chaîne Histoires Crépues, spécialisée dans la vulgarisation de l’histoire coloniale française, propose une analyse approfondie de la mission Dakar-Djibouti, menée entre 1931 et 1933. Cette expédition ethnographique, organisée dans le cadre de la politique coloniale française, visait officiellement à documenter et à conserver le patrimoine culturel africain. Cependant, elle fait aujourd’hui l’objet d’une contre-enquête conduite par des historiens africains et des spécialistes des études postcoloniales. Au-delà des prétentions scientifiques, cette mission est désormais reconnue comme ayant eu recours à des pratiques contestables, incluant la collecte massive, souvent coercitive, de plus de 3 600 objets provenant de diverses communautés africaines. En savoir plus |
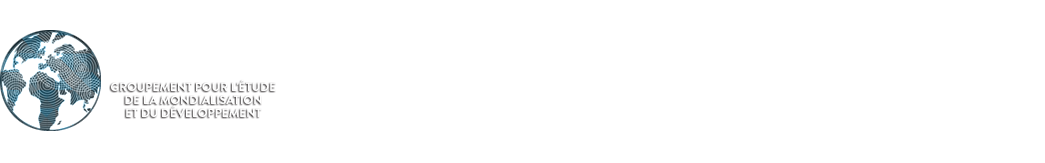 Gemdev
Gemdev