 Newsletter #605 – 16 juillet 2025 Newsletter #605 – 16 juillet 2025 Tribune « Tracer des frontières » par Jean-Baptiste Veber David Périer, géographe, professeur en classes préparatoires et rédacteur pour le magazine l’Éléphant, et Jean-Baptiste Veber, écrivain, historien, professeur d’histoire-géographie dans le secondaire et en classes préparatoires, mènent depuis plusieurs années une réflexion croisée sur les représentations de l’espace, les récits politiques et les enjeux contemporains liés aux territoires. Leur approche, à la jonction de l’histoire et de la géographie, propose une lecture critique des frontières comme constructions humaines : situées, contestées, parfois imposées, elles incarnent autant de rapports de force que de mémoires collectives. Des confins sahariens aux réserves amérindiennes, des zones économiques exclusives issues de Montego Bay à l’enclave russe de Kaliningrad, leurs analyses montrent comment les cartes héritées du passé structurent encore, en profondeur, les tensions du présent. En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, Jean-Baptiste Veber présente leur ouvrage Tracer des frontières (Éditions Novices, 2025), un essai de géopolitique accessible et rigoureux, construit autour de dix cartes et autant d’histoires de territoires. À travers ce livre, ils interrogent les logiques – politiques, historiques, mémorielles – qui président au découpage du monde. Pourquoi trace-t-on des frontières ? D’où vient la légitimité de ces lignes ? Quelles histoires, quels conflits, quelles aspirations portent-elles ? Une réflexion nécessaire sur les géographies invisibles, les héritages coloniaux et les équilibres fragiles qui continuent de façonner les relations internationales. Lire la tribune En savoir plus Article Une image coloniale ? Donald Trump et les chefs d’État africains Publié le 9 juillet 2025 Le Monde Pascal Blanchard, historien (CRHIM, Lausanne) partage son analyse de la récente réunion entre Donald Trump et plusieurs chefs d’État africains. Il y a 140 ans, la conférence de Berlin (1885) organisait le partage de l’Afrique entre puissances coloniales. En juillet 2025, une image emblématique en rappelle l’écho brutal : Donald Trump, assis en maître de cérémonie à Washington, convoque cinq chefs d’État africains – debout autour de lui – pour un « mini-sommet » aux allures de remake colonial. Le message est clair et assumé : «terres précieuses, minéraux rares, pétrole». L’Afrique n’est perçue que comme un réservoir de ressources à exploiter. Et Trump, fidèle à lui-même, humilie ses interlocuteurs, leur demandant de « dire leur nom et leur pays » et pas plus… avant de les interrompre pour leur faire la leçon. Ce sommet – qui n’a abouti à aucun engagement concret – visait surtout à contrer l’influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Mais il a surtout révélé la permanence d’un regard condescendant, extractiviste et dominateur. Du partage de Berlin à cette scène surréaliste de juillet 2025, l’Afrique continue de lutter pour changer ces images de domination. Découvrir l’article Découvrir l’analyse de Pascal Blanchard Événement Dédicaces de l’ouvrage François Mitterrand, le dernier empereur. De la colonisation à la Françafrique Samedi 19 juillet 2025 de 14h00 à 19h00 Port d’Orange (Saint-Pierre-Quiberon) Pascal Blanchard, historien et chercheur-associé au CRHIM (Lausanne), sera présent à la 15e édition du Quai des écrivains, à l’occasion d’une séance de dédicaces de l’ouvrage François Mitterrand, le dernier empereur. De la colonisation à la Françafrique (Philippe Rey, 2025), co-dirigé avec l’historien Nicolas Bancel… première étape de l’itinéraire estival du livre. Le livre met en lumière le rôle actif de François Mitterrand dans la gestion des colonies françaises : ministre de la France d’Outre-mer, puis ministre de l’Intérieur et de la Justice durant la guerre d’Algérie, il participe à des décisions majeures, notamment l’exécution de condamnés algériens. Devenu président en 1981, il poursuit une politique africaine marquée par le maintien de réseaux d’influence, la reprise des liens avec les milieux de la Françafrique, ainsi que des interventions militaires régulières sur le continent. En savoir plus Retour en image Conférence de Sandrine Lemaire autour de l’exposition « Racisme et Antisémitisme en images » Jeudi 10 juillet 2O25 Rectorat de Strasbourg (Strasbourg) Sandrine Lemaire, historienne et professeure agrégée en classes préparatoires au lycée Jean-Jaurès de Reims, est intervenue lors d’une conférence organisée devant l’ensemble des inspecteurs du rectorat de Strasbourg. Elle y a apporté son éclairage sur les enjeux liés aux discriminations, en lien avec l’exposition «Racisme et Antisémitisme en images. Discriminations, préjugés et stéréotypes», pour l’ensemble des inspecteurs du rectorat de Strasbourg. Cette exposition se propose d’explorer comment, au fil des siècles, certaines images ont contribué à façonner une culture visuelle porteuse de racisme et d’antisémitisme. À travers une sélection de corpus iconographiques, elle met en lumière les mécanismes par lesquels se construisent et se diffusent stéréotypes, préjugés, représentations xénophobes ou discriminatoires. En retraçant ces constructions visuelles, l’exposition invite à leur déconstruction du racisme et de l’antisémitisme à travers un cycle de conférences dans toute la France soutenu par la DGESCO (Éducation nationale), l’ANCT et la DILCRAH. En savoir plus France Commémoration Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France Dimanche 20 juillet 2025 à 10h15 Square du Martyr juif du Vélodrome d’Hiver (Paris 20e) À l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français, et du 83ᵉ anniversaire de la Rafle du Vél’ d’Hiv’, des cérémonies d’hommage sont organisées dans tout le pays. Elles rappellent l’ampleur de cette tragédie, qui vit l’arrestation de plus de 13 000 juifs – dont 4 000 enfants – par la police française, avant leur déportation vers les camps de la mort. Le monument commémoratif de la Rafle du Vél’ d’Hiv’, réalisé par le sculpteur Walter Spitzer – lui-même rescapé des camps – incarne aujourd’hui la mémoire de ces événements. Ces temps de recueillement sont également l’occasion de saluer le courage des Justes de France qui ont, souvent au péril de leur vie, protégé et sauvé des Juifs durant l’Occupation. Alors que le devoir de mémoire reste essentiel, ces commémorations invitent à une réflexion renouvelée sur les discriminations d’hier et d’aujourd’hui. En savoir plus France Festival 28e édition du festival des Théâtres d’outre-mer en Avignon Jusqu’au 24 juillet 2025 Chapelle du Verbe Incarné (Avignon) Pièces de théâtre, danses, performances… Les scènes de la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon accueilleront une programmation vibrante venue des Outre-mer. À travers des créations fortes, parfois politiques et toujours engagées, les artistes ultramarins donnent à voir la complexité, les tensions et les richesses de leurs identités. Ces œuvres interrogent les réalités contemporaines de leurs territoires. En investissant le Festival OFF d’Avignon, elles affirment leur place légitime au sein du patrimoine culturel français d’aujourd’hui. En savoir plus France Documentaire «Afrique-France : le divorce ?» En replay France Télévisions Ce documentaire réalisé par les journalistes Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova revient sur l’effritement des relations entre l’Afrique francophone et la France, ancienne puissance coloniale. Héritée de la colonisation et nourrie par les zones d’ombre de la « Françafrique », la relation avec Paris est aujourd’hui largement contestée : présence militaire perçue comme intrusive, accords jugés inégaux… Dans des pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin ou le Tchad, une nouvelle génération réclame souveraineté et rupture avec toute forme de tutelle. Sur fond de recomposition géopolitique, où s’imposent des acteurs comme la Russie ou la Turquie, le continent devient un espace de rivalités stratégiques. Dans une interview exclusive, le Président de la République Emmanuel Macron affirme dans ce film sa volonté de refonder les relations franco-africaines et de tourner la page des pratiques du passé. En savoir plus France Article « Restitution du tambour parleur Djidji Ayôkwé à la Côte d’Ivoire » Paru le 7 juillet 2025 RFI Dans cet article, la journaliste Marie Casadebaig revient sur la récente adoption, à l’unanimité, par les députés français, d’une loi autorisant le retour en Côte d’Ivoire d’un tambour parleur conservé en France depuis 1929. Cette décision marque une étape importante dans la reconnaissance du droit des pays d’origine à récupérer leurs patrimoines culturels. Cependant, cet acte isolé souligne aussi le retard de la France par rapport à certains de ses voisins européens, qui disposent déjà de cadres législatifs plus larges facilitant la restitution d’œuvres spoliées pendant la colonisation. En l’absence d’une loi-cadre générale, la France doit encore adopter des textes spécifiques pour chaque objet restitué, ce qui ralentit considérablement le processus de réparation et de reconnaissance. Ce vote pourrait toutefois constituer un premier pas vers une politique plus cohérente et ambitieuse de restitution du patrimoine africain. En savoir plus États-Unis Article « Soldier’s Paradise: Militarism in Africa After Empire » Publié le 22 juin 2025 Foreign Affairs Ken Opalo, politiste et professeur associé à l’Université de Georgetown, présente le récent ouvrage de Samuel Fury Childs Daly, historien et professeur à l’Université de Chicago, qui déconstruit l’idée largement répandue selon laquelle les coups d’État en Afrique se réduiraient à des prises de pouvoir opportunistes. L’auteur défend l’idée que le militarisme, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger, est souvent une réponse stratégique aux crises politiques. Selon lui, certains régimes militaires ont porté une véritable vision idéologique, cherchant à instaurer des sociétés plus disciplinées. En revisitant les motivations des dirigeants militaires, Samuel Fury Childs Daly propose une lecture nuancée des coups d’État, au-delà de leur caractère anticonstitutionnel, et apporte un éclairage original sur l’histoire politique du continent. En savoir plus France Revue « Recherches artistiques sur les restes humains » Parue le 25 juin 2025 Grahdiva La revue Grahdiva consacre son dernier numéro, dirigé par Frédéric Keck, directeur de recherche au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS-Collège de France-EHESS), et Lucia Piccioni, historienne de l’art (EHESS), aux multiples interprétations artistiques suscitées par les restes humains. Depuis longtemps, les artistes ont joué un rôle clé dans leur diffusion, à travers dessins, gravures, photographies ou moulages. Des exemples emblématiques, tels que le daguerréotype d’un crâne polynésien ou le moulage de Saartjie Baartman, témoignent de cette pratique. Aujourd’hui, l’art s’attache à redonner une identité à ces vestiges, à les reconfigurer poétiquement, dessinant ainsi une nouvelle relation entre création artistique, science et mémoire coloniale. En savoir plus |
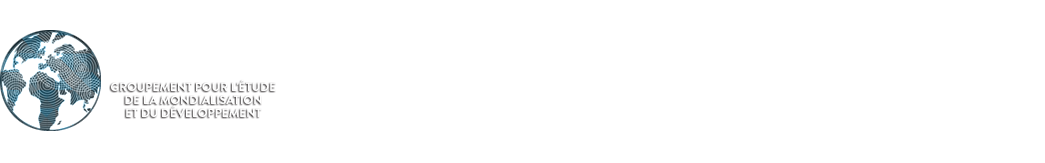 Gemdev
Gemdev